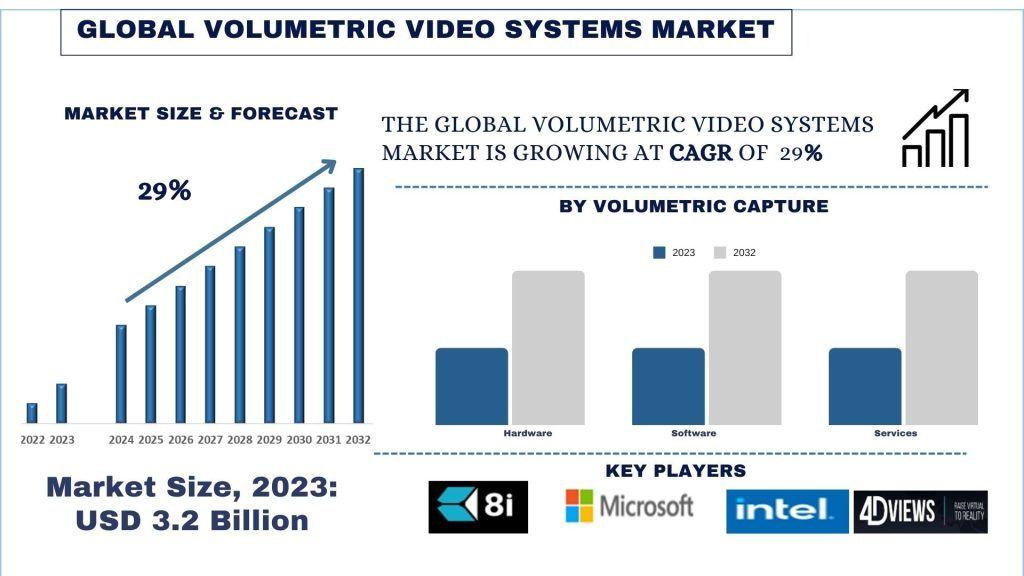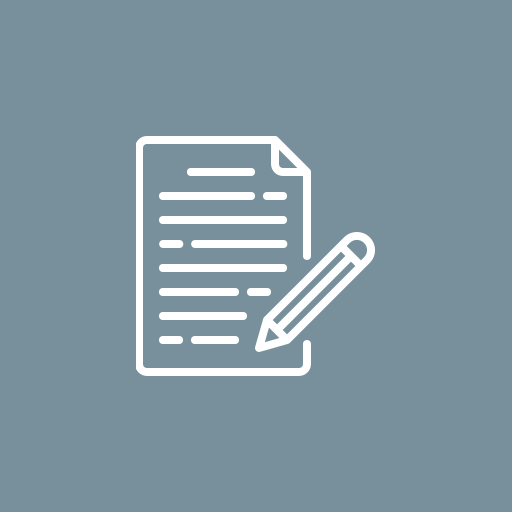Pendant près de trois siècles, de la fondation de la Régence d’Alger au début du XVIe siècle jusqu’à la conquête française en 1830, la Méditerranée fut le théâtre d’une guerre aussi discrète que redoutable : celle menée par les corsaires algériens. Loin des clichés de flibustiers sans foi ni loi, ces marins, souvent appelés "barbaresques" par les Européens, incarnaient une force militaire organisée, encadrée par l'État, et dotée d’une stratégie aussi audacieuse que redoutée. Leur activité, la « course », oscillait entre guerre légale et piraterie, dans un jeu géopolitique complexe où se mêlaient résistance, commerce, diplomatie et conflit.
Aux origines d’un empire maritime : la naissance de la Régence d’Alger
Tout commence en 1516, lorsqu’Aroudj Barberousse, marin d’origine grecque converti à l’islam et ancien pirate opérant en Méditerranée orientale, est invité par les habitants d’Alger pour les libérer du joug espagnol. Accompagné de son frère Khayr ad-Din, futur célèbre "Barberousse", il fonde un pouvoir maritime qui deviendra bientôt la Régence d’Alger, vassale mais autonome vis-à-vis de l’Empire ottoman. Dès lors, la ville d’Alger devient un repaire stratégique pour les marins engagés dans la guerre de course, une forme légale de piraterie soutenue par l’État, où les navires avaient pour mission de capturer les vaisseaux ennemis, principalement chrétiens, pour en revendre les marchandises et rançonner les captifs.
Une organisation étatique de la piraterie
Contrairement à l’image romantique du pirate solitaire, les corsaires algériens étaient souvent d’anciens soldats, marins professionnels ou renégats européens, encadrés par une structure quasi militaire. Chaque expédition était validée par une autorisation appelée "lettre de marque", et les butins étaient rigoureusement partagés entre l’équipage, les armateurs, et la Régence elle-même. La ville d’Alger, enrichie par ce commerce maritime offensif, voyait ses arsenaux se développer, ses chantiers navals se moderniser, et ses défenses côtières se renforcer pour devenir l’une des cités les plus redoutées du bassin méditerranéen.
Des figures emblématiques et redoutées des mers
Parmi les noms qui ont marqué cette période, celui de Hamidou ben Ali, surnommé Hamidou le Terrible, incarne à lui seul la puissance de la marine corsaire algérienne à la fin du XVIIIe siècle. Né vers 1773 à Boumerdès, il débute comme simple matelot avant de devenir l’un des plus célèbres capitaines de la Régence. Redouté des Espagnols, des Italiens, des Hollandais, mais aussi des Américains, il mène des campagnes audacieuses jusqu’au large de l’Atlantique, capturant des dizaines de navires ennemis. Il meurt en 1815 lors d’un affrontement naval avec la marine des États-Unis, illustrant l’ampleur qu’avait prise ce conflit maritime désormais mondial.
Une activité lucrative, mais décriée par les puissances occidentales
Si l’activité corsaire a longtemps été tolérée, voire pratiquée par les grandes puissances maritimes, elle devient un sujet de discorde majeure au tournant du XIXe siècle. L’Europe, qui renforce sa présence coloniale et maritime, commence à percevoir les corsaires d’Alger non plus comme des acteurs légitimes d’une guerre, mais comme des "pirates barbaresques", un terme lourd de connotations racistes et politiques. En 1815, les États-Unis, qui viennent de sortir victorieux de la guerre contre l’Angleterre, envoient une flotte bombarder Alger, forçant la Régence à signer un traité de paix mettant officiellement fin à la course contre les navires américains. Mais cette pression ne suffit pas à mettre fin aux activités corsaires, qui se poursuivent jusqu'à l’invasion française en 1830, événement qui scelle la fin définitive de la piraterie d’État en Méditerranée.
L’héritage contrasté des corsaires algériens
Aujourd’hui, l’histoire des corsaires algériens demeure à la croisée des regards. Pour certains, elle évoque une époque de puissance maritime et de résistance à la domination européenne, incarnant une forme de souveraineté défensive dans un contexte de domination coloniale montante. Pour d'autres, elle symbolise une période de violence, marquée par l’esclavage, les prises en mer, et une économie dépendante du pillage. Mais au-delà des jugements moraux, les historiens s’accordent sur un point : les corsaires algériens furent des acteurs incontournables du monde méditerranéen moderne, dont l’influence dépasse largement les frontières d’Alger.
Les corsaires algériens, souvent oubliés des grands récits historiques, furent les gardiens d’une époque où la mer Méditerranée était un champ de bataille mouvant entre empires et résistances. Ni simples pirates ni héros sans reproches, ils furent avant tout les produits d’un monde en mutation, où la survie passait souvent par la maîtrise des vents, des armes, et des alliances. Leur histoire, aujourd’hui redécouverte, éclaire d’un jour nouveau les tensions entre pouvoir, liberté, et souveraineté en mer.